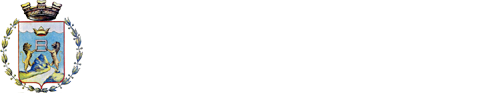LE TRAVAIL DU BÛCHERON
Les outils présentés ici concernent différentes étapes de la gestion forestière, de la coupe et du transport du bois de chauffage et du bois de construction. On y aperçoit des serpes et serpettes – des outils caractérisés par une large lame incurvée – qui servaient à couper les branches à travers la taille et l’élagage. Ce dernier consistait à couper les branches latérales des arbres que l’on faisait ainsi pousser droits, pour obtenir par exemple des mâts de bateaux. Les branches coupées étaient ensuite débarrassées de leurs feuilles à l’aide d’une serpette. Le bois était utilisé comme bois de chauffage, tandis que les branches les plus fines et les feuilles, tant fraîches que sèches, étaient utilisées comme fourrage pour les animaux l’hiver. Les haches et hachettes servaient à couper les branches les plus imposantes, comme dans la pratique de l’étêtage, mais aussi à abattre les arbres et à fendre ensuite le bois en bûches.
Nombreuses sont les scies de long et autres scies exposées, dont les différentes formes et dimensions sont liées à leurs divers usages (mais aussi, même s’il s’agit d’une histoire qui reste à écrire, à des chronologies différentes). Les scies, avec leur cadre rectangulaire et leur lame placée au centre, étaient utilisées par deux personnes et servaient à couper, directement à partir du tronc, des poutres et des planches pour la menuiserie ou la charpenterie (comme les poutres des toits, souvent en châtaignier). Les scies de long avec deux poignées aux extrémités étaient, elles aussi, utilisées par deux personnes et servaient à débiter les troncs, disposés sur des tréteaux (appelés chèvres de sciage). On aperçoit ensuite de nombreuses scies domestiques, pour couper des rondins de bois de chauffage. Dans cette partie également, les dessins accrochés aux murs aident à approfondir les usages spécifiques des différents outils.
Nombreux sont les outils qui se réfèrent au transport du bois. Parmi eux, les « rampini » (crochets de serrage en bois à deux trous) étaient de petits objets très importants. Ils servaient à lier les fagots de bois, à maintenir plusieurs objets ensemble, à serrer les cordes pour attacher les troncs, etc. De nombreux « rampini » de différentes formes sont exposés. Selon le curé de Montebruno, leurs différences ne dépendaient pas tant de leurs différentes fonctions que des différents styles typiques de chaque village, puisqu’ils étaient fabriqués à la main par les bûcherons et paysans eux-mêmes, l’hiver.
Les traîneaux étaient essentiels au transport des troncs et du bois le long des versants. Ces derniers pouvaient être utilisés pour traîner les troncs et, s’ils étaient équipés de paniers, pour transporter des morceaux de bois et d’autres objets. Les traîneaux étaient encore utilisés jusque dans les années 1950-1960. Après cette période, bon nombre de bois et de châtaigneraies autrefois exploités et gérés, ont totalement été abandonnés.
Au-dessus de nos têtes, on aperçoit en revanche la reproduction d’un autre système de transport, qui s’est notamment répandu dès le début du XXe siècle : le téléphérique, en dialecte « a strafía ». Il s’agissait d’un système de transport par câble qui reliait deux stations, une en amont et une en aval. Dans les systèmes les plus simples, la charge (les troncs ou le bois, les feuilles ramassées pour en faire du paillis et des litières ou du fourrage, ou même le foin) directement attachée au crochet ou à l’intérieur d’un chariot, ne pouvait que glisser par gravité vers la vallée. Dans d’autres systèmes, toujours équipés d’au moins deux stations, le câble passait sur une roue dentée qui, si elle était tournée mécaniquement, permettait de déplacer la charge tant en aval qu’en amont. Les téléphériques ont permis (et permettent toujours, puisque bon nombre d’entre eux sont encore utilisés) de transporter du bois et d’autres produits à partir de zones non desservies par les routes. Très souvent, ces téléphériques n’appartenaient pas à un seul propriétaire, mais leur utilisation pouvait être partagée, entre plusieurs personnes. Ce qui était le cas par exemple au sein des « comunaglie », aujourd’hui « biens communs », des espaces dont les droits d’usage ne relèvent pas d’un seul individu ou d’une famille, mais d’une collectivité (souvent le hameau) à laquelle, pour des raisons historiques, la possession de ces terres est reconnue. Les droits d’usage et d’accès à ces espaces et à leurs ressources étaient négociés au sein des collectivités, à travers des règles et coutumes pas toujours écrites – objet tantôt d’accords tantôt de conflits – étroitement liées et réitérées à travers les pratiques même d’utilisation. Ces espaces étaient une entité importante pour la subsistance des communautés montagnardes de l’Ancien Régime et permettaient de gérer et de produire une grande variété de ressources. La loi italienne les protège depuis longtemps en tant que biens culturels et leur reconnaît depuis 2017 un statut juridique autonome : les « domaines collectifs ». Historiquement, les bois et forêts étaient essentiellement des terres collectives, tandis que les châtaigneraies à fruits se trouvaient (et se trouvent) plus fréquemment sur des terrains privés (souvent en terrasses, entre le XVIIIe et le XIXe siècle).
La commercialisation du bois, notamment pour la charpenterie, la construction de grands centres urbains et l’industrie navale – notamment génoise – ont constitué un phénomène d’une importance considérable dès le Moyen Âge et à l’Epoque Moderne.
Jusqu’au XIXe siècle, l’aspect de ces bois était très différent de celui des bois actuels, car les arbres étaient bien plus clairsemés, en permettant ainsi à l’herbe de pousser, aux animaux de pâturer et à l’homme de faucher l’herbe. Les Apennins ligures et plus généralement la montagne ont connu, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, un fort développement de la commercialisation du bois lié aux nouvelles réglementations promues par l’administration du royaume de Sardaigne puis poursuivies par l’Etat italien créé en 1861. C’est au cours de cette période que les grands arbres, souvent séculaires, qui caractérisaient les pâtures arborées, ont été coupés pour produire du charbon, et que les espaces arborés sont devenus des bois taillis. Au début du XXe siècle, la production de charbon de bois a en effet été particulièrement encouragée comme l’un des moyens de rendre la montagne plus productive. La croissance de la production de charbon, à travers l’ouverture de charbonnières, et l’augmentation des ventes de ce produit ont été étroitement liées au processus de commercialisation des bois et sont également devenues centrales dans les activités économiques du Val Trebbia. Des activités qui avaient également lieu sur les versants du Mont Antola, où les traces de charbonnières sont encore bien visibles dans les hêtraies qui se sont développées sur d’anciennes pâtures arborées. On y voit en effet leurs anciens emplacements qui apparaissent comme des zones plates (avec, souvent, des traces de terrassement) sur des pentes raides.
Au cours de cette période, les figures du bûcheron et du scieur se joignent à celle du charbonnier dont l’activité se développe de plus en plus. Des métiers qui existaient déjà, mais qui ont occupé les bois des Apennins avec une nouvelle intensité. Même si le pâturage et le fauchage ne se sont pas poursuivis dans les bois devenus désormais trop touffus, les activités de ramassage des feuilles ont continué jusque dans les années 1960-1970. De même que d’autres activités de cueillette se poursuivent aujourd’hui comme celle des champignons ou des baies, à laquelle l’utilisation de bon nombre des paniers que nous avons vus à l’étage inférieur, était traditionnellement liée.