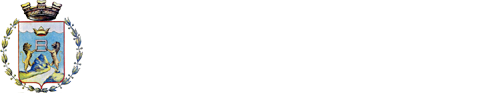CORDONNIER
Dans cette partie, on aperçoit les outils liés aux pratiques culturales. Il s’agit notamment de charrues et de houes, deux outils très anciens. Le choix entre l’utilisation de l’un ou de l’autre dépend en effet du type, de la pente et de l’étendue du terrain à travailler.
Comme on le sait, les techniques de labour et de semis se sont mécanisées à partir des années 1930 -1940, en apportant, notamment dans les zones de plaine, de profondes modifications dans les pratiques liées à la culture. En montagne et sur les versants en terrasses, compte tenu des pentes et des espaces plus restreints, ces changements ont été moins brusques, les outils à bras étant souvent préférables encore aujourd’hui, car peu encombrants et facilement transportables.
Dans cette partie, on peut voir un soc, une charrue en bois utilisée pour remuer la terre et creuser des sillons, souvent tractée par des bovins, notamment des bœufs.
On aperçoit ensuite une grande variété de binettes et de bêches, toutes en fer forgé, accrochées aux murs. Une fois fixées sur des manches en bois, ces dernières étaient utilisées dans différentes étapes du semis et de la culture.
Comme on peut le voir, elles ont des formes et des tailles différentes, qui dépendent des divers usages auxquels elles étaient destinées. Les binettes trapézoïdales étaient souvent utilisées pour aplanir les mottes de terre et créer des sillons pour les semis. Pour les sols les plus durs, on préférait les pioches et les grosses houes, même très lourdes, de forme triangulaire, équipées de pointes permettant d’ameublir la surface.
Les bidents et tridents pouvaient être utilisés pour des sols plus caillouteux, mais aussi pour remuer la terre autour de plants déjà germés, en permettant une plus grande perméabilité du sol autour de ces derniers.
Il convient également de rappeler que jusqu’à la fin du XIXe siècle, on ne cultivait pas seulement les terrasses et les champs proches des zones habitées, mais aussi les versants les plus éloignés où les semis de céréales à cycles courts (les « cultures temporaires ») étaient encore fréquents. Ces versants étaient souvent des terres d’usage collectif, les « comunaglie », également utilisées pour le pâturage et la coupe et le ramassage du bois, dans une alternance d’usages qui, par cycles même de dix ans, concernaient les mêmes espaces. Dans ces espaces, l’utilisation de bidents et de grosses houes était essentielle pour préparer le sol.
Avec le XIXe siècle, en revanche, suite également aux réformes d’abord promues par le Royaume de Sardaigne puis par le Royaume d’Italie, les utilisations des espaces agricoles, pastoraux et forestiers se sont de plus en plus orientées vers la monoculture. C’est pourquoi il est difficile à l’heure actuelle d’imaginer qu’il y ait eu des pâtures bordées d’arbres ou des bois de pâturage, où la distance entre les arbres permettait également à l’herbe de pousser, laquelle était utilisée pour le pâturage et fauchée pour produire du foin l’hiver. De même qu’il nous est difficile d’imaginer qu’il y ait eu une utilisation contrôlée du feu pour limiter la croissance des mauvaises herbes et la propagation des plants d’arbres dans les zones qui devaient rester ouvertes, ou que les cendres issues du brûlage des émondes, ait été éparpillées pour fertiliser les sols, ou encore que les champs cultivés étaient ouverts au pâturage libre après la récolte et avant les semailles.
On aperçoit également dans cette partie toute une sélection de pelles, et, plus loin, sur les étagères, de pioches et d’autres types de pelles. Les pioches étaient, elles aussi, utilisées pour ameublir le sol : les plus petites étaient préférées pour le sarclage, c’est-à-dire pour ameublir le sol autour des racines de la plante en croissance, en creusant autour d’elles de petites rigoles pour favoriser leur respiration. Les pelles que l’on aperçoit ici pouvaient être utilisées à différents moments liés à la culture, pour déplacer par exemple de grandes quantités de terre, créer des canaux pour guider l’eau de pluie et éviter que les cultures ne soient submergées en cas de très fortes pluies.
Ces outils ne servaient pas seulement à l’agriculture, mais étaient également destinés à d’autres usages dont, par exemple, la production de chaux. Cette dernière était obtenue en creusant des trous, des fours à chaux, où les pierres calcaires étaient mises à cuire. Lors de la cuisson, les houes larges (comme celle en forme de cœur) et les pelles étaient utilisées pour mélanger et déplacer la masse de chaux puis pour l’aplanir, avant de l’éteindre. Du fait des hautes températures atteintes au contact de la chaux encore vive, le fer se corrodait souvent partiellement, en laissant des traces visibles de ce type d’utilisation. Les mortiers de chaux avec lesquels les maisons ont été construites et rénovées jusqu’aux premières décennies du XXe siècle, tout comme les enduits avec lesquels ces dernières étaient recouvertes, étaient en effet tous à base de chaux produite localement. Rien d’étonnant donc à ce que ce type d’activité se soit diffusé dans la région de l’Antola, qui donne son nom à une formation géologique qui caractérise un large secteur de la Ligurie orientale et que l’on appelle justement « formation des Calcaires du Mont Antola ».
Cette partie accueille également les outils liés au battage et à la ventilation du blé. Plusieurs batteuses sont exposées, dont on comprendra facilement le fonctionnement et la chronologie en observant les dessins accrochés aux murs. Ces dessins aident également à comprendre la façon dont était utilisé le crible, qui servait à séparer le grain de la balle.
Ces dessins, tout comme les autres que l’on peut observer dans toutes les salles du musée, ont été spécialement réalisés pour le Musée entre la fin des années 80 et le début des années 90 et aident à comprendre la nomenclature et la fonction de bon nombre des objets exposés ainsi que le contexte dans lequel ils étaient utilisés.