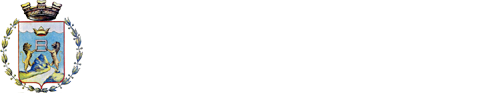FENAISON
Les outils exposés ici sont liés à différentes étapes de la fenaison. On aperçoit ainsi une grande collection de faux, à longs manches, dont on se servait pour la plupart du fauchage des prés et dont l’utilisation est attestée dès le Moyen Âge, comme en témoigne par exemple l’une des mosaïques dédiées aux mois de l’année, conservées dans l’abbaye de Bobbio et datant de peu après l’an 1000.
Le travail était ensuite achevé à l’aide de faucilles, des outils plus petits, transportables fixés à la ceinture. Certains des râteaux servaient en revanche à ramasser les feuilles tombées des arbres à l’automne, que l’on regroupait ensuite dans des cages de paille et qui servaient à faire du paillis et des litières dans les étables. Les râteaux en bois étaient surtout utilisés pour ramasser les châtaignes.
La récolte du foin débutait généralement à la fin du printemps, non seulement pour les champs destinés à la fenaison, mais aussi pour les zones dont les usages étaient diversifiés : vignobles, châtaigneraies, pâtures arborées. Des espaces plus grands étaient souvent destinés au fauchage à proprement dit, qui commençait après le début de l’été (entre juin et juillet) et qui, en fonction des vallées et de l’évolution de la météo, pouvait être répété, généralement une à deux fois, jusqu’au mois d’octobre.
Il était impératif que les faucheurs emmènent des marteaux et enclumes avec eux, pour affûter et redresser les lames des faucilles et des faux pendant le travail. Les modes d’utilisation de ces outils sont bien décrits sur les dessins accrochés aux murs, qui permettent également de connaître la terminologie locale utilisée pour les définir. Les doigtiers étaient également essentiels, lesquels servaient à protéger les doigts de la lame de la faucille, car si la faux heurtait une pierre, la lame pouvait « sauter » et atteindre les doigts du faucheur.
Le foin était ensuite étalé sur la surface fauchée et laissé sécher quelques jours. Les fourches et râteaux permettaient un ramassage plus rapide, même pour le foin très dense. Pour pouvoir transporter le foin, on le rassemblait dans des filets rectangulaires constitués de cordes attachées à deux bâtons placés aux extrémités, ou dans des « cages » de paille ou d’osier, souvent utilisées également pour le ramassage du paillis et des feuillages. A partir du début du XXe siècle, le transport pouvait également s’effectuer via des systèmes de téléphérique, dont une reproduction est visible dans la partie dédiée au « Bûcheron ».
La récolte du foin était une activité fondamentale sur les collines ligures, qui a évolué parallèlement aux activités liées à l’élevage, tant ovin-caprin que bovin, et à l’alimentation des animaux de transport (comme les mulets et chevaux) mobilisés dans les activités de transit. Les tiges de blé qui étaient coupées à l’aide d’outils spécifiques pouvaient, elles aussi, être utilisées comme foin pour les animaux.
Comme indiqué, le foin pouvait être produit tant à partir du fauchage des prairies en zones ouvertes, qu’à partir du fauchage de l’herbe qui poussait dans les châtaigneraies, même en terrasses, ou dans les espaces arborés (les pâtures arborées dont on parle dans la partie consacrée au bûcheron). Le fauchage était, en l’occurrence, l’une des diverses activités qui, avec le semis de cultures temporaires, le pâturage, la coupe du bois, etc., étaient réalisées au sein de cycles qui pouvaient durer plusieurs années. Tout cela avait surtout lieu sur les terres collectives, les « comunaglie », dont les familles et communautés avaient la jouissance, selon des règles coutumières. Avec l’affirmation des Etats administratifs modernes à partir du XIXe siècle, ces usages et modes de gestion ont toutefois été jugés peu rationnels et pas assez productifs. Les Etats centraux ont ainsi encouragé des processus de vente des terres collectives pour qu’elles aient un propriétaire et que la monoculture devienne désormais la norme.
Les terres à usage collectif étaient des entités particulièrement complexes, difficilement compréhensibles selon des catégories préétablies à ce niveau institutionnel. Les usages multiples et diversifiés des ressources environnementales et des espaces étaient en effet difficiles à intégrer dans un processus plus large de rationalisation des espaces de production, nécessaire selon la conception urbano-centrée des institutions du XIXe siècle. Le territoire a donc été de plus en plus défini selon des catégories restrictives, caractérisées par des activités spécifiques, telles que les bois, les pâturages, les zones cultivées et les zones en friche. Si l’histoire des terres collectives de Montebruno, de Torriglia et des alentours reste à écrire, il peut toutefois être intéressant de noter que contrairement à ce qui se passe pour Propata, Rondanina, Fontanigorda, à Montebruno et Torriglia, les terres collectives n’ont pratiquement pas été conservées.
C’est à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que le pâturage dans les espaces arborés a été progressivement interdit. Au cours du XIXe siècle, de nombreuses réglementations prévoyaient la mise en culture ou le reboisement des espaces ouverts classés « zones en friche ». Qui plus est, la privatisation progressive des terres et des bois communaux ou à usage collectif a été fortement encouragée. Les interventions visant à rendre la montagne plus productive ont également concerné l’élevage, avec la limitation des formes de transhumance de longue distance et l’incitation à des formes d’élevage sédentaire, où les animaux étaient menés « à l’alpage » l’été (la « transhumance »), mais stationnaient dans les étables des villages l’hiver. C’est pourquoi lors de la seconde moitié du XIXe siècle, la production de foin a considérablement augmenté, suite également à la réalisation de prairies permanentes. La fenaison est devenue une activité centrale non seulement en tant qu’activité de subsistance pour la production animale locale, mais aussi en tant qu’activité commerciale importante reliant les versants aux vallées, puisque le foin obtenu à partir du fauchage était également récolté, vendu et utilisé comme fourrage pour les animaux, notamment les bovins, que l’on faisait stabuler dans la vallée les mois d’hiver. Dans l’arrière-pays ligure, le fauchage était effectué à la fois par les membres des communautés locales et, au cours du XIXe siècle, par des ouvriers agricoles venus d’autres régions d’Italie du nord.
A partir de la seconde moitié du XXe siècle, avec la disparition également des formes d’élevage local, les activités de fauchage sont, elles aussi, peu à peu délaissées. La conséquence de l’abandon de ces pratiques est visible dans les espaces hors des zones habitées, où dans les zones autrefois utilisées comme prairies, l’absence de fauchage et de pâturage a entraîné la disparition des bonnes espèces fourragères qui étaient entretenues par ces pratiques, en favorisant la croissance des arbustes et, plus tard, l’avancée des bois qui caractérisent aujourd’hui les versants situés au-dessus des villages. La transformation des étables et des granges en habitations ou en entrepôts, ou leur effondrement, constitue une autre trace de ce processus d’abandon toujours en cours.