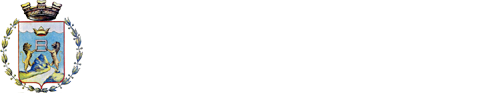INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Les instruments regroupés ici nous racontent différentes histoires et laissent entrevoir les différentes façons dont la musique a été pratiquée au fil du temps, en nous rappelant à quel point la musique et la culture musicale étaient répandues bien avant notre époque.
En haut, on aperçoit un accordéon de fabrication allemande. Il s’agit d’un modèle diffusé au XIXe siècle, grâce à sa plus grande maniabilité et simplicité par rapport aux harmoniums qui sont ses « ancêtres ».
Il s’agit d’un accordéon diatonique à boutons, qui se distingue tant des accordéons chromatiques, caractérisés par un plus grand nombre de tons et un timbre différent, que des accordéons pianos. Les accordéons diatoniques se sont répandus vers la seconde moitié du XIXe siècle : c’est en 1829 à Vienne que le premier brevet d’accordéon à boutons a en effet été délivré. La forme de ces instruments au XIXe siècle correspond à celle d’aujourd’hui.
Les caractéristiques de cet instrument, déjà tirées de certains prototypes de l’époque Moderne, visaient à le rendre facilement transportable. Un aspect qui devient fondamental avec les modèles du XIXe et du XXe siècles et c’est sans doute la raison pour laquelle il a vite été associé à l’activité des musiciens ambulants, vu son adaptabilité même aux petits espaces.
C’est en tant qu’élément inévitablement lié à la culture « populaire » que cet instrument est entré dans l’imaginaire contemporain. L’accordéon évoque en effet immédiatement l’idée de musique populaire, folklorique, de fêtes de village et de convivialité.
Aujourd’hui, les fêtes sont tout naturellement liées et de façon presque métaphorique aux activités pastorales et agricoles. Lorsque cet instrument était utilisé, dans la première moitié du XXe siècle, les foires aux bestiaux, les fêtes champêtres, comme celles du début de la floraison, des vendanges et des récoltes, ou encore les « Maggi », représentaient un instant où la fête suivait ou entrecoupait des moments d’activités menées ensemble et souvent avec l’aide de personnes provenant d’autres villages plus ou moins proches. Ces fêtes sont bien attestées à l’époque moderne, mais leur signification et modes d’organisation changent considérablement entre l’épode Moderne et le XIXe siècle.
Il convient également de rappeler qu’au cours du XIXe siècle, tous ceux qui jouaient dans ces fêtes étaient très souvent des musiciens ambulants qui se déplaçaient entre les Apennins ligures et émiliens, et entre les montagnes et les plaines du Piémont et de la Lombardie. Ces musiciens (qui, souvent, exerçaient également d’autres activités) faisaient partie d’un flux important de migrations saisonnières qui concernait également les bergers transhumants, les charbonniers, les scieurs, les merciers et vendeurs ambulants, sans oublier les maçons. Il s’agissait souvent de paysans qui exerçaient d’autres activités de façon saisonnière ou d’artisans spécialisés qui, au cours de l’année, exerçaient leurs activités dans des lieux différents, en traversant les frontières régionales et nationales.
Si la pratique de la musique a conservé sa valeur de distraction lors des fêtes et dans les salles de bal, avec la disparition des activités de gestion des espaces hors des zones habitées, celle-ci a progressivement perdu sa dimension plus rituelle et ses liens intimes avec la vie sociale des communautés et donc son côté habituel.
La disparition du lien entre fêtes et espaces hors des zones habitées est liée à l’abandon, progressif après le milieu du XXe siècle, des activités agricoles et pastorales. On peut également y réfléchir en observant cette riche collection de papillons, concernant des espèces courantes en Ligurie.
Il s’agit de papillons d’origine locale, collectés il y a plus de 30 ans dans les montagnes entourant Montebruno, par le curé et l’un de ses amis lorsqu’ils se rendaient dans les prés pour classer les fleurs, notamment dans la zone de Monte Spigo qui était le lieu où l’on récoltait la lavande (« spigo » en dialecte signifie lavande). Bon nombre de ces papillons, tous encore très répandus en Italie, ont aujourd’hui malheureusement disparu dans la région, les prés qui constituaient leur habitat étant désormais abandonnés. Ces derniers ne sont en effet plus fauchés et les animaux ne viennent plus y paître.
La quasi-totalité des espèces de la collection appartient en effet à des espèces fréquentant de préférence les prairies fleuries (ou les jardins et vergers). On peut y apercevoir certains spécimens d’espèces que l’on trouve souvent dans les clairières ou à l’orée des bois. L’observation de ces papillons nous rappelle que si les bois ont désormais fortement progressé autour de nous suite à l’abandon des prés, il y a encore 30-40 ans, la zone entourant Montebruno était en revanche pleine de prairies et d’espaces ouverts.
Cette collection inclut 1 à 4 spécimens de 25 (ou 26) espèces appartenant à trois familles de Rhopalocères italiens : 1 Papilionidé, 6 Piérides et 18 (ou 19) Nymphalidés.
Les espèces herbacées (graminées, crucifères, légumineuses, violettes, centaurées, plantains, orties) représentent une grande partie des plantes alimentaires des chenilles. Le Flambé et le Gazé font exception puisqu’ils préfèrent les rosacées ligneuses comme le prunellier et la cédronelle, dont les chenilles peuvent se trouver sur les feuilles de nerpruns et de troènes.
Sous les instruments de musique, on aperçoit une riche collection de figurines de crèche en plâtre et papier mâché. Accrochées aux murs de la salle, juste devant les instruments de musique, on peut voir les images qui témoignent des différentes étapes de préparation d’une meule de charbonnière expérimentale réalisée en 1999 par Canessa Marco de Montebruno et Luigi Casazza de Conio di Rondanina. On reviendra sur la production du charbon dans la partie consacrée aux bûcherons.
Au fond de la salle, une collection d’isolateurs électriques en porcelaine et d’interrupteurs « anciens » provenant de la rénovation des maisons de Montebruno et des villages environnants.