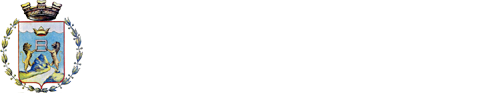LA CAVE
On se trouve ici devant la partie qui concerne la cave. Bon nombre des objets exposés sont étroitement liés à la production du vin, entre baquets, cuves et tonneaux. La viticulture est toujours une activité très répandue sur les versants ligures, côtiers et de l’arrière-pays. Au XIXe siècle, le vin était produit tant pour la vente que pour la consommation domestique. Ce qui est toujours le cas aujourd’hui, certes dans une moindre mesure. Les objets exposés permettent de reconstituer le « cycle du vin ».
Après les vendanges, le raisin était foulé, tant à la main, qu’à l’aide de bâtons, à l’intérieur de grandes cuves, ou, pour de plus petites quantités, dans des tonneaux ou baquets. Les baquets sont des récipients généralement plus bas et larges que les tonneaux, caractérisés par deux poignées sur les côtés, comme on le voit là-bas. Le produit du foulage était ensuite laissé fermenter quelques jours dans les baquets, pour pouvoir ensuite en extraire le moût, en le séparant du marc de raisin. Le moût, après une courte sédimentation dans des baquets ou cuves, une fois devenu limpide, pouvait être transvasé dans les cuves et les tonneaux pour la fermentation consécutive.
En outre, on aperçoit ici un pressoir, composé d’un corps central de forme cylindrique, de deux blocs de bois placés au-dessus et au-dessous de celui-ci et d’un mécanisme à rotation sur une vis centrale qui pouvait être actionné par un levier, absent ici. Le marc de raisin était déversé dans le pressoir après séparation du moût, pour être pressé et en extraire un liquide plus trouble que le vin, qui devait donc être filtré plusieurs fois, avant d’être laissé reposer dans les tonneaux. Le vin « pressé » était souvent conservé par les familles pour un usage domestique et non destiné à la vente.
Plusieurs tonneaux sont exposés. De grands récipients où on laissait le vin lors de la période de fermentation puis la période de repos. On aperçoit, en outre, une dame-jeanne, un récipient en verre recouvert de paille tressée, où le vin était transvasé après quelques mois de repos dans les tonneaux, et à partir duquel il pouvait être transvasé plus tard dans des bouteilles et des fiasques.
La balance devant nous, nous permet de voir la façon dont a évolué l’instrumentation liée à la production et à la commercialisation du vin (et de l’huile d’olive) au début du XXe siècle. Cet instrument permettait en effet de peser les tonneaux, en les fixant à l’intérieur des deux bras du crochet central. Cette balance, datant des premières décennies du XXe siècle, provient de l’usine de poids, mesures et balances Michele Grasso de Gênes, dont l’entrepôt – comme indiqué sur l’objet lui-même – était situé via Sottoripa, 133. Il s’agit d’un modèle particulièrement intéressant, car il rappelle, par sa forme, sa légèreté et sa portabilité, les balances romaines, dont un exemple est visible au premier étage du musée. Les balances romaines étaient utilisées pour peser de petites marchandises et objets. Si elles étaient largement répandues dans le cadre domestique et commercial, elles auraient toutefois difficilement permis de peser des objets de plus grandes tailles, tels que les tonneaux par exemple. Une autre balance, cette fois de précision comme en témoignent les nombreux poids, provient d’un magasin de Montebruno et remonte au milieu du XXe siècle.
L’organisation de cette partie reflète un autre rôle important des caves : des espaces étroitement liés aux espaces domestiques où, au fil des ans et suite aux diverses évolutions des usages et des pratiques agricoles, productives et commerciales, ont été déposés et « empilés » des objets de contextes différents et de diverses époques, n’étant plus utilisés ou utilisés occasionnellement.
Sur les étagères de ce couloir, on découvre – sous forme d’objets – une multitude d’aspects de la vie des familles et des communautés montagnardes du Val Trebbia, se référant pour la plupart à la période comprise entre le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, avec toutefois la présence de matériels même plus anciens, hérités des générations précédentes. A droite des objets caractéristiques de la production vinicole, on aperçoit une très belle collection d’ustensiles de cuisine. Les cuvettes dites « tachetées », en raison du décor tacheté qui les caractérisait, et les différentes marmites en céramique vitrifiée, sont essentiellement des productions du XIXe siècle, largement répandues en Ligurie. Il s’agit de productions rarement locales, qui offrent une trace des réseaux commerciaux dans lesquels Montebruno s’était intégrée. Les petites marmites avec leur intérieur jaune, datant des dernières décennies du XIXe siècle, sont particulièrement intéressantes. Il s’agit de « petites marmites provençales », des productions de Savone et d’Albisola pour la production desquelles on utilisait de l’argile de Provence. La grande soupière et les plats exposés dans la « Cuisine » proviennent également de la même zone de production et datent de la même époque. Il s’agit ici de « faïences jaunes décorées à l’éponge ». Des productions qui, à cette époque, ont été vendues, depuis l’Ouest de la Ligurie, dans toute la Ligurie et l’Italie centrale et septentrionale.
Les nombreux moulins étaient utilisés pour moudre le café, l’orge et constituaient jusqu’aux années 1960/1970 un objet incontournable des foyers et des épiceries. Bon nombre d’entre eux peuvent être datés des premières décennies du XXe siècle. A cet étage, on aperçoit en outre toute une collection de poêles et d’ustensiles pour torréfier le café et l’orge (« brestulin »), datant de la première moitié du XXe siècle. Ces derniers suggèrent la diffusion croissante de cette boisson, qui s’est de plus en plus imposée dans la vie quotidienne des familles au siècle dernier.
En nous déplaçant plus loin, la collection de planches à découper, dont certaines très usées, de râpes à pain ou à fromage, de machines à pâtes, de hachoirs à manivelle, de mortiers, de fourneaux à loger dans le « runfò » (ndt : ancienne cuisinière en maçonnerie fonctionnant au bois ou au charbon) (l’évolution du plat en terre cuite qui était utilisé dans la cheminée), mais aussi de meules, de barattes pour la production de beurre, nous révèlent également les activités réalisées dans les maisons pour produire les aliments consommés par la famille. On retrouve également d’autres aspects de la vie de famille sur ces étagères : un chauffe-lit, caractérisé par une structure en bois (appelée « moine ») qui permettait d’insérer une chaufferette en métal ou en terre cuite au milieu. Une fois placé entre les couvertures et le matelas, il permettait de réchauffer le lit et d’éviter l’accumulation d’humidité les mois d’hiver. En nous déplaçant vers les étagères suivantes, en rejoignant les parties sur les semailles et la fenaison, on aperçoit de nombreux objets liés à l’hygiène personnelle, comme des bassines, mais aussi des lanternes, dont certaines modernes, et toute une variété d’outils pour divers travaux, pour la création et la réparation d’outils agricoles ou d’autres ustensiles, tels que des peignes à myrtilles, des planches à découper présentant désormais de profonds sillons liés à un usage prolongé.
La richesse du matériel présenté ici met en évidence le nombre d’activités réalisées au sein des familles et nous montre que la production d’aliments et d’objets pour leur propre consommation était étroitement liée à des réseaux commerciaux et de communication de grande envergure. L’extrême variété et les différentes époques des objets que l’on aperçoit nous montrent une fois de plus le nombre d’activités qui ne sont plus menées de la même façon, ou avec la même intensité, et nous permettent également de commencer à saisir toute la complexité des groupes sociaux qui ont utilisé ces objets, en traversant et en réalisant de petits et de grands changements dans leur vie et quant à leurs besoins.