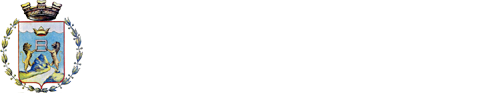ÉTABLE
On aperçoit ici des objets et équipements liés aux animaux de trait, dont le rôle a évolué et changé au fil du temps et eu égard à l’évolution et à la disparition progressive de bon nombre des activités agro-sylvo-pastorales ayant caractérisé la vie de ces versants des Apennins.
Commençons par le mur couvert de colliers et de sonnailles (ndt : cloches et clochettes) de différentes tailles, et découvrons ensemble les animaux qui étaient élevés dans ces régions. Les sonnailles et les colliers les plus grands étaient souvent portés par les vaches et les bœufs, tandis que les plus petits étaient portés par les chèvres et les moutons. Les colliers étaient presque toujours sculptés en bois de cytise ou de châtaignier par les paysans et bergers eux-mêmes, pendant l’hiver. D’autres colliers pouvaient être en cuir et prendre la forme de courroies.
Les sonnailles étaient sélectionnées en fonction de leur son, car elles devaient permettre au berger ou au paysan d’identifier ses animaux au pâturage et de connaître leurs déplacements dans les zones d’alpage. Les sonnailles les plus petites étaient destinées aux chiens.
Tandis que les moutons et les chèvres étaient presque toujours en transhumance et stabulés sur la côte, les bovins qui étaient amenés aux pâturages communs l’été, étaient stabulés l’hiver dans les étables des villages. C’est entre le XVIIIe et le XIXe siècle que l’élevage bovin local s’est considérablement développé (et, avec lui, la construction d’étables et de granges) dans ces régions, comme dans d’autres des Apennins ligures. Quant à l’élevage ovin et caprin, il a en revanche diminué, jusqu’à disparaître presque totalement au début du XXe siècle avec l’interruption des circuits de transhumance de longue distance.
Mais pendant longtemps, les bovins avaient également été des animaux de trait, utiles pour des activités telles que le labour des champs. Les nombreuses « pianche » constituent une trace de cette utilisation, des fers pleins qui étaient fixés aux bœufs de traits (deux par sabot). D’autres fers étaient destinés aux chevaux ou, dans le cas des plus allongés, aux mulets et aux ânes. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, mulets, ânes et chevaux avaient constitué le seul moyen de transport des marchandises sur de longues distances.
A partir du Moyen Âge et jusqu’au XIXe siècle, Montebruno, avec d’autres localités comme Torriglia, a constitué un axe important au sein du réseau de chemins muletiers qui reliaient Gênes et les autres ports ligures à la plaine du Pô, dans un circuit d’échanges entre la Méditerranée et l’Europe centrale. Le transport et le commerce à longue distance ont subi un grand changement avec la construction de routes carrossables après la formation du Royaume d’Italie puis avec la mécanisation au milieu du XXe siècle. Le réseau de chemins muletiers des Apennins est toutefois resté fondamental au niveau local et son utilisation était encore loin d’être rare dans les années 1960 et 1970. Pour preuve, les nombreux bâts pour mulets exposés ici, et les autres conteneurs de transport qui pouvaient être utilisés pour les marchandises, le fumier et le sable prélevé dans le fleuve.
La section de l’étable se poursuit avec d’autres équipements liés à l’élevage : cages à poules, muselières pour veaux (pour éviter qu’ils ne s’accrochent à la mère qui devait être traite), mangeoires et râteliers, placés en hauteur pour les chevaux et en bas pour les bœufs, hottes à porter sur les épaules pour le transport de feuillages et de foin utilisés dans l’étable.
Enfin, une partie de cette section accueille les harnais décoratifs utilisés lors des foires et des fêtes, où les animaux y participaient également, en y jouant parfois même un rôle central.
Ici, on aperçoit en effet des colliers colorés et décorés, spécialement conçus pour les fêtes et les foires des localités du Val Trebbia. Bien que ces dernières aient pu être préservées au fil du temps, les pratiques agricoles, notamment depuis le début du XXe siècle, ont de moins en moins fait appel aux animaux de trait. A partir de l’après-guerre, les animaux d’élevage ont en effet peu à peu disparu de la vie domestique et du quotidien, pour être de plus et plus relégués à l’élevage intensif. Dans les années 70 et au début des années 80, il était encore courant d’avoir une vache ou quelques moutons, outre des lapins, des poules et des cochons, ce qui n’est plus si fréquent. Les traces de la disparition de la cohabitation avec les animaux s’entrevoient également dans l’habitat : les étables et les granges sont abandonnées lorsqu’elles ne sont pas réutilisées pour d’autres usages, tout comme par exemple les porcheries. Comme déjà mentionné, la progression des bois constitue également une trace de la disparition des animaux domestiques, des bois qui envahissent de plus en plus les espaces autrefois ouverts. En effet, avec la disparition des pâturages et du fauchage lié à la production de foin pour les animaux, la croissance des arbres n’est plus maîtrisée, avec des conséquences néfastes sur la stabilité des versants et la dangerosité des incendies. Ces dernières années, dans le Val Trebbia, des expériences de retour à l’élevage susceptibles d’inverser cette tendance, commencent à voir le jour.